Le crayon noir.
Publié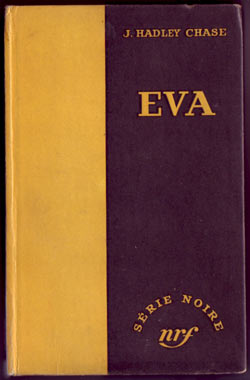
A la fin des années cinquante, mon père, lecteur de base de France Soir, achetait épisodiquement Radar. Je découvrais donc le soir à la maison les Unes du journal qui faisaient la part belle à Di Marco. Je tremblais avec tous les gosses de mon âge devant des trains mugissant, prêts à découper la chair tendre d’une belle fille. Des femmes se faisaient étrangler par des terreurs de banlieue et des couteaux jaillissaient dans la nuit parisienne. J’ai donc vécu une enfance marquée par le drame en compagnie de Di Marco.
Le temps passa. Je dégottai, dans une location de vacances en Bretagne, une vingtaine de vieilles Série Noire cartonnées qui firent mon bonheur du mois d’août. Et découvris les Steve Fischer, Harry Whittington, William O’Farrell, Day Keene, John D. Mac Donald qui me tirèrent bien loin de ma banlieue sans souci pour m’entraîner dans les rues sauvages des Etats Unis, au coeur des villes minées par la corruption et au sein de couples détruits par l’appât du gain, la tromperie, la trahison. Entre Di Marco et ces écrivains directs et sans concessions, j’étais mûr pour le côté obscur de la vie.
Au début des années 70, je contemplais la peinture de Jacques Monory, qui n’est pas dessinateur mais peintre, et me scotchai à la représentation de la violence, bleutée chez lui, et notamment à sa série des Meurtres. Durant quatre ans, j’avais étudié à Estienne et mon goût pour l’image s’en était trouvé conforté car le dessin était central dans l’enseignement de la vénérable école.

Munoz et Sampayo me surprirent au coin d’une librairie. Était-ce Tschann, à Montparnasse ou déjà La Hune qui paradait près des Deux Magots ? J’ai oublié. Mais la série Alack Sinner des deux argentins me sauta aux yeux comme disent les gens. Le dessin tordu de Munoz prenait ses distances avec Di Marco et l’absence de gris tirait l’ensemble vers une graphie résolument moderne. Pour moi qui travaillais comme graphiste, je venais de dégotter le boire et le manger. Qui plus est, ces deux-là me racontaient des histoires, lointaines cousines des narrations de Chandler et de son Marlowe, chevalier blanc toujours présent malgré l’omniprésence du héros-flic.
Nous étions au tout début des années 80 et le producteur de Neige (dont j’avais rédigé le scénario) eut l’idée de confier l’affiche à Guy Peellaert, dessinateur que j’avais méconnu. Je me précipitai sur son oeuvre et découvris un peu plus tard son chef-d’oeuvre : Las Vegas the Big Room, consacré aux personnages qui hantent les palaces de la ville du jeu, du vice et des exécutions au pied des tuyas dans le désert environnant. Peellaert travaillait à la mine et ses images veloutées mais cependant précises tiraient son art vers le musée. Je me souviens de Jimmy Hoffa, blême devant son taxi, Bugsy Siegel roulant sa caisse au bar de l’hôtel ou encore Lenny Bruce envapé dans une salle d’attente.
Puis les années 80 m’engloutirent.

Dans l’ordre : je publiai plusieurs recueils de nouvelles noires dans la collection Le Miroir Obscur dont les couvertures étaient dessinées par Jean Claude Claeys. Il travaillait à l’aide de photos mais réinterprétait les clichés en noir et blanc, au trait, au lavis. On retrouvait ici la geste de Di Marco mais revue et corrigée par l’absence de sensationnel et une imagerie contemporaine empruntant notamment au cinéma et à la photo.
La revue Chic, qui paru au début des années 80, se donnait pour mission de constituer des duos dessinateur-écrivain, à charge pour les uns et les autres de produire de petites BD noires. Je fus apparié avec Loustal dont je connaissais le nom mais pas le travail. Je rendis mon scénario, truffé de bulles et de dialogues. Aux antipodes du travail de Jacques qui faisait plutôt dans la sobriété et cantonnait les textes sous le dessin. Je me corrigeai donc et nous rendîmes deux histoires à la revue qui cessa de paraître quelques mois plus tard. Concernant Loustal, je veux faire un arrêt-image sur son livre, réalisé avec Paringaux et intitulé Barney La Note Bleue. Hommage et réécriture de la vie du saxophoniste Barney Wilen, cet ouvrage est une réussite totale d’autant qu’il permit à Barney, provisoirement oublié, de revenir en première ligne sur le front du jazz.
J’ai du faire connaissance avec Romain Slocombe quand il publiait Prisonnière de l’armée rouge. Marqués par Bazooka, ses dessins d’une grande précision photographique se sophistiquaient d’année en année et nous convînmes de travailler sur un format à l’italienne chez Futuro. Le thème qui nous emballait tous les deux était lié à la violence dans l’Amérique des années cinquante. Il dessinerait de son côté et j’écrirais du mien. Je reconduirai plus tard cette façon de travailler avec Miles Hyman et le photographe Derouinau. En fait, l’idée est simple : les deux créateurs ne doivent être en aucun cas l’illustrateur l’un de l’autre. Nous intitulâmes le livre Cauchemars climatisés et il parut en 1987.
A cette époque, deux expériences me tirent l’oeil dans la presse et l’édition. Toutes les deux renvoyant à l’univers graphique noir ou polar.
La première publication parait chez Les Humanoïdes Associés et s’intitule Chandler, la Marée Rouge. Jim Steranko est aux crayons et au texte, Jean Patrick Manchette à l’adaptation en français. Steranko propose un hybride entre la BD et le roman illustré : chaque image est située dans le haut de la page et le texte typo en dessous. Il propose un noir et blanc sans fioriture qui rappelle les pulps de la grande époque. La seconde publication est l’oeuvre conjointe de Tardi et Manchette, Griffu, qui paraît chaque matin, tel un feuilleton, dans le quotidien Libération. Là aussi nous voyageons dans le noir et blanc et le dessin de Tardi préfigure ce qu’il deviendra dans ses adaptations de Léo Malet et plus récemment celles de Jean Patrick Manchette.
Autour de notre sujet mais pas si loin, je rappelle le fabuleux générique réalisé par Guy Peellaert pour l’émission Cinéma-Cinémas. La caméra se balade sur un immense dessin réalisé sous forme de scénettes par Peellaert. A chaque station, c’est la bande-son qui signe, en quelque sorte, le film et son titre.

Dans les années 90, je propose à Miles Hyman un projet noir sur un quartier qui me tient à coeur : Pigalle. Miles avait déjà travaillé sur ce quartier et nous décidons de développer ce sujet. Il complète donc le travail commencé pendant que j’imagine une fiction noire en phase avec les lieux. Ici, comme avec Slocombe, nous travaillons en parallèle et Miles livre de très belles illustrations sur le quartier. Depuis quelques années, ce champion du black and white est passé à la couleur. Il la travaille par strates superposées, nourrissant la matière sous-jacente de l’image. C’est Eden qui édite ce livre, aujourd’hui épuisé.
Les années 2000 ne sont plus très loin. La disparition de Futuropolis, l’un des rares éditeurs capable de s’engager sur autre chose que de la BD, indique la fin des livres texte/dessins et laisse la voie libre aux BD noires. A la même époque des dessinateurs de grand talent s’intéressent à l’univers du polar : Baru, Chauzy, Tardi, Loustal, Pourquié, Ferrandez. Accompagnés par des auteurs immergés eux aussi dans le Noir : Jonquet, Pécherot, Benacquista, Charyn, Mau, Pelot.
J’avais fait une première tentative BD avec Romain Slocombe sur un scénario original, Cité des Anges (1989) mais l’expérience tourna court. Aussi, je pris plaisir à lire les autres : Chauzy-Jonquet (La vie de ma mère), Ferrandez-Benacquista (La boîte noire), Loustal-Charyn (Les frères Adamov), Pourquié-Pécherot (Des méduses plein la tête). En 2005, Casterman me contacte et me propose de travailler avec eux. Nous nous entendons sur un titre de roman (Rouge est ma couleur) et on me présente Chauzy avec qui, depuis, j’ai adapté deux de mes titres. A la même époque, François Guérif (Rivages) et le scénariste Matz (Le tueur) lancent des discussions avec Casterman en vue de créer une collection dont les scénarios seraient adaptés des romans de la collection Rivages-Noir. A charge pour Casterman de contacter et faire travailler des dessinateurs séduits par le polar, le noir, le mystère et j’en passe. Cette collection, unique en son genre, se développe donc et l’un des premiers livres à paraître est Pauvres Zhéros. La fiction minimaliste et névrotique de Pelot tape dans l’oeil de Baru qui plaque sur le scénario des images brutales, sans concession et faciles de lecture. En fait, cet album réussi évoque pour moi un bon petit film anglais, noir et hargneux. De nombreux dessinateurs et auteurs font équipe, depuis, dans cette collection ou aux alentours (je pense à Olivier Mau, Fred Vargas, Edmond Baudoin).

Les écrivains et les dessinateurs sauront-ils se retrouver au-delà du passage obligé par la BD ? Je le pense. Récemment, je rendais une nouvelle au magazine Tango et nous convînmes de demander une illustration à Loustal qui accepta. Les liens existent, les deux genres, souvent malmenés par la littérature officielle, ont intérêt à unir leurs forces et leurs talents. Et, pourquoi pas le dire, à poursuivre un compagnonnage souvent synonyme de plaisir. La création solitaire n’est pas une figure imposée.