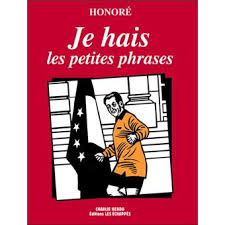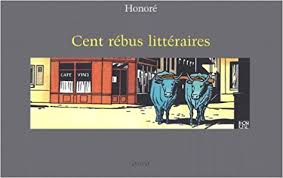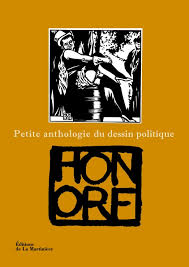Honoré, géant des Batignolles.
Publié
Honoré publie son premier dessin en 1957 dans Sud-Ouest, l’année où il découvre Sempé dans la presse. Ce dessinateur restera pour lui une influence quant à l’approche sardonique mais indulgente des hommes et des sociétés. Par contre, le graphisme de Sempé ne marque pas le jeune homme qu’on appelle encore Philippe et qui troquera son nom complet contre le seul patronyme Honoré. Il faut chercher du côté de Valloton, Topor et Gustave Doré, les artistes qui marqueront le débutant, au niveau du trait et de l’organisation de l’espace. Les gravures sur bois de Valloton et sa maitrise du cadrage séduisent Honoré, de même que les linogravures de Topor et ce non-sens à la british que le post-surréaliste propose. Enfin la qualité du dessin de Gustave Doré et sa science du travail trouvent un écho fort chez le jeune artiste. Le mot travail est prononcé ici car Honoré appartient à une société de dessinateurs peu enclins à brosser en quelques traits un personnage. Afficher une facilité de surface n’est pas dans ses intentions. Il développe, au contraire, un travail renvoyant à celui d’un artisan inspiré. Celui d’un « bénédictin de gauche » (on l’imagine sourire, découvrant ce raccourci).
Concernant Honoré, nous devons parler du noir. Et du blanc. Car les gris disparaissent dans ses images. Le noir profond claque sur la page blanche, le cadre rappelle le cinéma expressionniste et, plus proche de nous, les photos de Daido Moriyama.
En pénétrant dans le monde de la caricature, Honoré est reconnu comme un maître mais pour parler en « journaliste du dessin », il va flanquer ses images de textes éclairants. Décalés, cinglants, ils appuient là où ça fait mal. La grande force d’Honoré, dessinateur de presse et caricaturiste, donc, c’est de pouvoir ajouter du texte ou s’amuser, selon son humeur, à signifier avec le seul dessin.
Ce choix du noir et blanc pourrait indiquer un individu rigoriste, droit dans ses bottes, peu sensible aux gris et aux incertitudes du quotidien. Mais dans la vraie vie, l’homme était bien différent. Attentif aux autres, ami fidèle, père aimant, cultivé, prêt à la discussion, Honoré n’était pas un tiède mais son approche de la nature humaine restait bienveillante.
Le mot culture vient d’être prononcé et c’est à dessein. Car en créant ses rébus pour le magazine Lire, Honoré invente le jeu littéraire dessiné. Il s’amuse avec le livre et amuse les autres. Nombreux sont les lecteurs qui ont transpiré sur ces fameux rébus mais qui, beaux joueurs, durent admettre la malice de l’auteur.
Le mot cinéma est noté au début de ce texte et il faut y revenir. Durant deux ans, dans le cadre de Charlie Hebdo, Honoré et le critique-écrivain Michel Boujut hantèrent les projections de films. Chacun rendait compte à sa façon de l’oeuvre visionnée. Le dessinateur mutait vraiment en journaliste et rejetait l’habit triste de l’illustrateur. Cette époque a marqué Honoré. Car cette position de journaliste, il la revendiqua depuis ses débuts. En homme qui pense et réfléchit, il souhaitait faire exister ses idées par ses dessins plutôt qu’enjoliver les propos des autres.
Cette confiance en lui, son travail d’artiste et sa puissance de conviction sont les éléments-clés qui définissent le mieux l’homme que j’ai connu.
On ne peut évoquer Honoré sans parler de Paris, du 17e arrondissement et du quartier des Batignolles. Le dessinateur était un piéton de Paris. Un marcheur, aurait dit le poète Yves Martin. Nez au vent, petite besace en bandoulière, il arpentait de préférence son arrondissement, discutait avec tout le monde, chipotait la qualité des betteraves, goûtait un Bordeaux inconnu au Bloc, son bistrot favori, poussait la grille d’une maison de Jacques Brel, racontait aux amis la vie d’un ancien claque de la rue des Moines, faisait le point sur la situation internationale avec son libraire, confisquait une vieille peinture abandonnée, compilait d’anciens numéros de La vie du rail esseulés sur des poubelles. Bref, un homme comme on les aime. Il a été tué dans la salle de rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. MV.
Rue Clairaut, en compagnie d’Honoré.
Un midi où nous étions dans la galerie de Francisco, je demandai au dessinateur comment lui était venu l’idée d’acheter sa chaumière située dans l’Oise. Il convint qu’à l’époque il avait mis de côté quelques sous et le nord était moins onéreux que le sud. En visitant des maisons, il fut introduit dans le jardin de celle qui devint la sienne. Pas vraiment convaincu par le jardin, il ouvrit la porte du bâtiment et un essaim de papillons jaillit de l’ombre vers le ciel bleu. C’était vendu, disait Honoré. Un jour que j’en parlais à Hélène, elle me confia qu’il avait un peu enjolivé la réalité mais, comme dirait l’autre, quand la fiction est bonne, oublions la réalité. Ce n’est pas tout à fait la phrase mais vous comprenez l’idée, n’est-ce pas ?
Parfois nous étions en signature avec Honoré dans la librairie d’Hervé, rue Brochant. Il s’asseyait dans un coin et les lecteurs de Tango venaient réclamer leur dessin dédicacé. Il s’installait donc, tranquille, et ça durait une éternité. Je me disais « Ils vont reprendre la revue et dire qu’ils n’ont pas la nuit » mais non. Les lecteurs éclusaient des verres de pinard en contemplant un dessinateur qui avait du temps à leur consacrer. Ils en ont marre des types qui gribouillent le même dessin à la va-vite. Ici, le grand les prenait au sérieux, ils pouvaient carrément dîner de cacahuètes et de vin rouge. Oui, car Honoré ne buvait que du vin rouge, du sud-ouest, de préférence.

Voici deux ans, un voisin d’Honoré part en vacances en lui confiant son poisson rouge. Etait-il d’extraction noble, ce poisson ? Personne ne sait mais, dès les premiers jours, le dessinateur commence à s’inquiéter car le poisson bouge peu. Un matin, il ne bouge quasiment plus, réifié au fond du bocal. Honoré, vaguement terrorisé, donne un petit coup de pouce sur le dos du poisson qui file brusquement à l’autre bout du bocal. Renseignement pris, il dormait. Cette information mit Honoré en joie. Du coup, il redoubla d’ardeur dans les soins au poisson. Notamment, il décida de lui changer son eau trop souillée. Il fit l’acquisition de quelques litres d’eau de source et transbahuta la poiscaille pour lui changer son élément. Pas mécontent de lui, il s’ouvrit à son libraire de son activité. Malheureux, s’écria Hervé, jamais d’eau de source pour un poisson, toujours celle du robinet. Honoré, du coup, refit la manœuvre dans l’autre sens. La saga aquatique se poursuivit quelque temps et j’ignore comment le dessinateur parvint à respecter les délais de Charlie durant sa période de « veille du bocal ». Photo ci-dessous : Arnaud Baumann.

Extraits d’une interview d’Hélène Honoré donnée à L’Humanité.
"Souvent, on se questionnait, avec beaucoup d’humour : « Qui vit sans exploiter les autres ? » Et on se disait, en rigolant : « Céline Dion ! » Qu’elle soit riche ne pose pas de problème. Elle n’exploite personne. Qu’on n’aime ou pas ce qu’elle chante, elle vit de son travail. L’idée de se placer du côté de ceux qui vivent de leur travail et non pas du travail des autres était essentielle pour mon père. Son engagement en ce sens s’étendait d’ailleurs à tout être vivant, y compris aux animaux dont certains sont exploités, réduits à l’état de choses, par pur intérêt financier ou par plaisir pour certains. Il a longtemps été militant dans un syndicat, à défendre notamment les droits des pigistes. Il était de gauche. Évidemment. Il a voté Mélenchon à l’élection présidentielle. Mais n’était plus engagé dans un parti depuis les années 1980, tout en portant grand intérêt à la politique au sens propre du terme. Il avait intégré ses valeurs. Il les vivait. À travers le dessin politique, il pouvait s’exprimer. C’est peut-être aussi cela qui a fait qu’il ne ressentait plus le besoin de militer au sein d’une organisation. Ses dessins n’avaient pas vocation à imposer quoi que ce soit en tant que tel. Mon père ne faisait que livrer sa lecture du monde, sans obliger quiconque à penser comme lui. « Voilà comment ce monde fait écho en moi », c’était le sens de son travail."

" Dès l’âge de seize ans, il voulait être dessinateur. C’était son rêve. À la fin des années soixante, il n’était pas absurde de compter en vivre. Il a dû quitter l’école très jeune pour aider sa mère, dont l’épicerie avait fait faillite. Autodidacte, il est devenu d’abord dessinateur industriel. Dès qu’il a pu, il s’est mis à mi-temps, pour vivoter de ses dessins. Et puis, à partir du milieu des années soixante-dix, il a pu commencer à en vivre. Il travaillait à temps très plein. Pour ne pas dire tout le temps. Il n’allait dans les locaux de Charlie que le mercredi, pour la conférence de rédaction. Il travaillait chez lui, entouré d’énormément d’archives nécessaires à sa manière très documentée de dessiner. Il ne caricaturait pas en déformant le visage et le corps des gens, mais en mettant en scène l’homme politique, en le costumant, en le plaçant dans un décor subtil. Donc, il avait besoin de s’informer sur les tenues vestimentaires, sur les lieux. Il éduquait sans cesse son œil. Il aimait les livres, les photos, les tableaux. Il les accumulait dans son atelier de l’appartement des Batignolles. Nous allions souvent voir des expositions. Cela nourrissait son étonnante mémoire photographique.

"Il était aimé. Entouré d’amis qui constituaient sa famille, notre famille. Fidèle, tous les mardis, il passait du temps avec eux… Il adorait aussi répondre aux demandes de conseils des jeunes, de l’école d’art et d’industrie Estienne, par exemple. Maintenant, moi comme les autres, il faut tout faire pour que son travail, et celui des autres dessinateurs, ne soit pas interrompu… par quelques-uns. Chacun aujourd’hui doit trouver sa manière de s’exprimer. De reprendre son destin en main. Que chacun fasse vivre ce sursaut. Pour que le combat continue. Reprenne, en fait. Car, depuis quelques années, la société subit trop. Que leur mort soit une terrible occasion pour que chacun d’entre nous, d’entre vous, participe à la vie politique du pays, s’engage. Que cet engagement nouveau se passe dans le cadre professionnel ou personnel, à travers un hobby, un blog… Que ceux qui ont envie de lancer un journal satirique le fassent ! Choisir un dessin, l’imprimer, le coller dans un bureau ou ailleurs, c’est déjà prendre la parole. C’est ce que les gens commencent à faire en ce moment. Il faut un sursaut, chacun à sa manière ! Voilà. Pour que tout cela ne finisse pas par le retour au ronron qui précédait. Reprenons la parole !"


J’ai écrit la nouvelle qui suit dans laquelle apparait Honoré. Elle est incluse dans un recueil consacré au métro parisien dont le titre est Métroland (in8°.
Brochant.
Le Consul descend l’avenue de Clichy, le pas lourd et l’œil incertain. Il tient dans ses bras deux chihuahuas rachitiques de couleur approximative. L’un répond au sobriquet de Fifi et l’autre à celui de Lulu. L’homme sort d’un point d’eau dispensant un pur malt sérieux. Il en a bu trois, trinquant par la même occasion à la France éternelle qui fut celle des colonies. Quand la grandeur signifiait. Quand on vénérait le drapeau, messieurs, quand le cœur de la nation battait à l’unisson. Avant l’arrivée des communautaristes analphabètes.
Il est donc bien. Lourd mais bien. La station de métro Brochant est située à 150 mètres et avec un peu de chance il peut y parvenir à pied. Les brumes de l’alcool troublent la périphérie de son cerveau fatigué. Le voici transporté dans le pays qui fit sa gloire, le Zambiland. Quand on lui donnait du Monsieur le Consul, champagne à gogo, mousmés pour cirer les godasses, danse du ventre et on en passe. Une prégnance de savane bienvenue grimpe vers ses narines, la brousse chuchote dans sa tête et le piétinement de ses boys rentrant chez eux à l’issue d’une bonne journée de travail, concluent cette ivresse des sens.
Le Consul affectionne l’obéissance. La notion de puissance a toujours tenue une place privilégiée dans son cœur et cette grandeur génétique, il pense l’avoir fait descendre au niveau des humains. En clair : chez les nègres. Si le Consul appartenait à une classe qu’on dira vulgaire, il pourrait s’en repaître mais non, il a simplement le sentiment du devoir accompli.
Pour le moment, son devoir consiste à gagner la bouche de métro puis, au terme d’un voyage de 12 stations, à consulter son ami Villetard-Boucheron. Un véto qui chouchoute ses clébards. Lulu fait un début d’allergie et Fifi perd l’appétit. Oui, c’est un problème.
Sur le quai opposé à celui qui intéresse le Consul, un homme portant barbe et cheveux blancs est penché sur un dessin. Il croque un poivrot, assis à quelques mètres, à l’aide d’un pinceau à encre. Son costume est en velours noir. Il lui donne l’allure d’un artiste au regard doux mais précis. A l’apparition du Consul, il lève un œil, sourit discrètement et revient à son dessin.
Notre homme, flanqué de ses chiens, se rapproche du bord du quai en compagnie de trois autres voyageurs. La rame pénètre avec fracas dans la station et au moment où elle parvient vers le groupe, une ombre passe furtivement. Le consul, poussé dans le dos, perd pied, va pour chuter sur la voie mais une main agrippe son imper et le retient in-extremis. Par contre, dans l’affolement, les deux roquets mexicains échappent aux mains de leur maître et disparaissent sous la première voiture, puis la seconde, puis la troisième. Voyant cela, une femme volumineuse nantie d’un cabas se prend à hurler. Les enfants détournent les yeux et le Consul, hagard et solitaire, chuchote « Lulu, mon Lulu ». C’est son préféré. On doit préciser ici que le Consul n’exerce aucun favoritisme quotidien à l’endroit du chien mais, bon, un sucre par ci, une gorgée de cognac par là, indiquent la partialité de ses sentiment. Evidemment, l’homme à l’origine de ce mouvement de foule a disparu. Le mécanicien de la rame descend, essaie de retrouver la trace des clébards chétifs mais non, tout est noir sous les wagons. Du coup, il se dirige prestement vers un téléphone mural et, un peu pâle, hésite entre prévenir le Central ou son psychanalyste. Il opte pour le job et alerte monsieur Marcel, chef d’équipe à la RATP.
Cheik Tiéné marche vite dans les rues du quartier Brochant. Il remonte l’avenue de Clichy, coupe à droite rue Clairaut et gagne son logement rue Nolet. Un septième étage sans ascenseur. Yasmina, un tablier coloré sur le ventre, tend le visage vers celui de son époux.
– Alors ? dit-elle.
– Raté. Mais les chiens sont restés sous le métro.
– Cet homme est mauvais, pas ses chiens, Cheik. Tu veux que je raconte encore Zambicity ?
– Oui, raconte encore, ça me donnera de la force.
– Alors voilà. Ma grand-mère elle est malade à Thionville. Il faut que j’aille pour m’occuper d’elle. Du coup, je dois demander un visa pour la France. Je vais donc à la maison du consul, ce chien, et je fais la queue deux heures pour mon visa. Il est là, ce cochon gratté, à me regarder de bas en haut comme un cheval et il dit : « Je sais pas, ça demande réflexion ». Moi je dis « Mais monsieur le consul c’est ma grand-mère qui peut mourir et je dois la trouver ». Alors il dit : « Je peux faire un effort, viens me trouver après le travail ici, j’aurai le temps ». Et le soir quand je viens, il veut mettre son engin dans mes cuisses et moi je crie et je me bats alors il est tout rouge et il dit « Tu resteras au Zambiland jusqu’à ta mort, bamboula ».
– Il a dit « bamboula, c’est sûr ?
– Comme je te vois.
– Je vais essayer un autre jour.
Ce même soir, le consul pleure entre les seins de sa femme d’origine africaine. Il dit qu’il veut retourner petit garçon, il veut de la confiture d’abricot, jouer avec des Dinky Toys, collectionner les vignettes Panini, surtout celles de Beckenbauer. Son épouse très patiente lève les yeux au ciel et lui caresse le crâne en pensant au Brésil. Il appelle Lulu et même Fifi, il sanglote et dit qu’il va sortir car il étouffe ici. En fait, il a besoin d’un verre. Il descends donc l’escalier et fait semblant de ne pas voir le peintre qui travaille au rez-de-chaussée puis retrouve le boulevard. Deux anciens de la légion lui font signe, attablés près de la vitre du Relais, un rade qui pourrit lentement par le bas car la mort commence par les pieds. C’est du moins ce que disent les médecins. Dix minutes plus tard, les anciens militaires se moquent de lui car il ne connaît pas la vallée de la Soummam. Il était trop jeune pour l’Algérie.
– J’aurais aimé casser du bougnoule, dit le Consul.
Les deux hommes le contemplent avec tristesse. Il dirait n’importe quoi pour leur plaire mais les vieux bidasses en ont trop vu. Les nyaks, les bougnoules, les nègres, ils en ont tué des paquets. Aujourd’hui, ils constatent que leurs meilleurs potes du quartier Clichy sont ceux qu’on leur commandait de décimer dans leur jeunesse. Aussi, les propos guerriers du consul les affligent.
– C’est toi qui paies la tournée, Consul. Très trop con, dit le chauve.
– J’ai perdu mes deux chiens aujourd’hui.
– C’est pas une raison, tu paies. Morts comment ?
– J’ai été bousculé sur le quai du métro et ils m’ont échappé.
– Tu bois trop. Je peux t’avoir un épagneul breton, c’est mon logeur tunisien qui veut s’en débarrasser, dit l’allemand.
– J’en parle demain à ma femme.
Le temps passe ainsi en discussions de comptoir. A une heure du matin, quand ils sortent du bar, le consul, franchement ivre, chute contre un arbre et s’allonge par terre.
– Je reste ici, dit-il mollement.
Au petit matin, deux policiers en tenue déposent le consul contre la porte de l’atelier du peintre situé en boutique. L’ancien du Zambiland a perdu ses clés, les locataires de l’immeuble refusent d’ouvrir à l’autorité et les pandores n’ont pas encore avalé leur breakfast. Du coup, le Consul termine sa nuit arrosée dans les vapeurs de l’huile et de l’acrylique.
A deux cents mètres de la rue Clairaut, Cheik Tiéné est déjà sur le quai du métro Brochant, direction Mairie d’Issy. Il essaie de visualiser sa prochaine agression. « Voilà, il arrive comme ça, je passe lentement, le train déboule et hop, coup d’épaule et je l’envoie dinguer sur les rails. Et là, schlak, en morceaux, le consul de merde ».
A l’extrémité du quai opposé, le dessinateur est toujours en place, attentif à son travail. Il prend des notes sur l’architecture métallique de la station et s’amuse des gesticulations du Black. Puis, le grand dessinateur gagne la sortie et en prenant la rue Clairaut pour gagner son immeuble, tombe en arrêt devant le corps recroquevillé du Consul. « Abruti » murmure-t-il et il passe son chemin, requis par une faim légitime. Il est 9h30.
A 17h30, le Consul est réveillé. Il s’est coupé trois fois en se rasant et se dépêche car il a rendez-vous avec l’ordonnateur de pompes funèbres affecté au cimetière canin de Clichy. Il a prévu des obsèques grandioses pour les chihuahuas rétrécis. Les cercueils seront fermés pour les raisons que l’on sait. Devant la boutique du vendeur de DVD 100% Jésus, il croise une femme noire qu’il ne reconnaît pas. Elle crache sur son passage. Avant de pénétrer dans le métro, il entre au Balto et se colle au zinc.
– Un double baby, dit-il.
– Un normal, alors ?
– Heu … oui, peut-être.
Le garçon se tourne vers ses bouteilles en grinçant « gros con ». On doit convenir ici que le Consul n’est pas très populaire dans son quartier.
Deux minutes plus tard, une femme trainant derrière elle un corniaud incolore s’accoude au zinc et réclame « Une Côte » d’un ton péremptoire. Contre toute attente, le Consul engage la conversation avec cette habituée des lieux. Bien vite, un dialogue abyssal les absorbe dont le thème central est le suivant : si un curé est homosexuel, faut-il dire « Monsieur le curé » ou « Madame le curé ». C’est un sujet sensible qui anime régulièrement les poivrots basés non loin des Batignolles.
Il faut faire ici un break narratif. Nous sommes donc en compagnie du Consul, au métro Brochant, dans la ville de Paris, capitale de la France. Sur une planète nommée Terre. Un peu plus bas, Cheik Tiéné, patiente, rencogné contre un distributeur automatique de tickets et de cartes Navigo. Autour d’eux, la vie continue mais n’est-ce pas ce qu’on pourrait nommer une image figée de la bonne vieille lutte des classes ? Un homme de pouvoir, mauvais donc, face au peuple zambilandais méprisé mais en lutte pour son intégrité physique. Oui, on peut le dire.
Pris de boisson, le Consul laisse derrière lui le bar et la femme au corniaud. Il descend les premiers degrés de l’escalier menant aux quais où l’attend un mari outragé. Le peuple noir opprimé vaincra-t-il, pour changer ? Les rapports nord-sud en seront-ils modifiés ?