John Harvey : violence et compassion
PubliéPropos recueillis par Jean-Paul Gratias et Marc Villard.
John Harvey, né à Londres en 1938, a vécu de nombreuses années à Nottingham, une ville qui a inspiré la série de Charlie Resnick. Aujourd’hui, il vit avec Sarah Boiling et sa plus jeune fille, Molly.
Durant de longues années, il écrit des fictions pour le livre de poche, destinées aux adultes et adolescents. On lui doit, à ce jour, quatre-vingt-dix titres, parmi lesquels de nombreux westerns. En 1976, il passera à la fiction criminelle avec Amphétamines and Pearls sphere et signera Dancer Draw a wild card, son dernier roman hors série, puisque Lonely Hearts, premier tome des Resnicks Novels paraît en 1989.
Abonné à la fiction criminelle, il continue cependant à écrire pour la télévision et la radio. Il a adapté pour la radio des textes de Graham Greene, Richard Ford, Jayne Ann Phillips et bien d’autres. Poète, il a publié dans de nombreux supports et ses poèmes ont été rassemblés dans Ghost of a chance. Il pratique assidûment la lecture en public, accompagné parfois d’un groupe de jazz, Second Nature. John Harvey a créé les éditions Slow Dancer Press en 1977, pour donner leur chance à des poètes qu’il affectionne. En 1988, cette maison d’édition s’ouvre à la fiction avec une préférence marquée pour les textes traversés par le jazz et le blues : Solo Hand de Bill Moody, Ladder of Angels de Brian Thompson, New Orleans Mourning de Julie Smith...
En fait, la carrière de John Harvey prend une dimension nouvelle quand il crée son flic, Charlie Resnick, ancré dans un commissariat d’une ville de province, qui est rarement nommée, mais qu’on devine être Nottingham. Publiés par Viking, les Resnicks Novels sont inspirés autant par Mc Bain que par la série télévisée Hill Street Blues.
Ce qui fait la différence, c’est le tempo -ternaire - de conteur d’Harvey, la compassion de Resnick, le côté provincial des intrigues qui ne tombent jamais dans une littérature de ploucs. Comme dit Resnick : « Moi, je suis né ici, dans cette ville, c’est ici que j’ai grandi ». Notre homme est divorcé : Elaine, son ex-femme, prétendait visiter des maisons pour abriter leur bonheur mais en fait se faisait culbuter par un bellâtre dans des appartements-témoins. Un peu triste, n’est-ce pas ? Du coup, Charlie s’enfonce dans sa condition de célibataire entouré de ses quatre chats : Dizzy, Miles, Bud et Pepper. Des boppers, ça va de soi. Son commissariat est l’objet de tensions permanentes : Kevin Naylor et ses problèmes conjugaux ; Lynn Kellog, en quête d’identité ; Mark Divine, connard macho de service et Jack Skelton, qui a bien des soucis avec sa fille. Charlie Resnick paraît être le seul à garder la tête froide dans ce microcosme, avançant dans l’investigation pour débusquer la vérité et pouvoir retourner chez lui se passer ses vieilles cires sur sa chaine.
Outre les dix romans consacrés à Resnick et promis par Harvey, celui-ci a publié dans sa propre maison d’édition les onze nouvelles concernant Charlie, sous le titre Now’s the time. Elles ont toutes connu une première publication dans des revues ou anthologies. L’une d’entre elles, -Cool Blues- figure dans un remarquable recueil collectif (Blue Lightening) consacré à la musique. Le casting en est somptueux : Kirsty Gunn, Walter Mosley, James Sallis, Charlotte Carter, Ian Rankin, Stella Duffy...
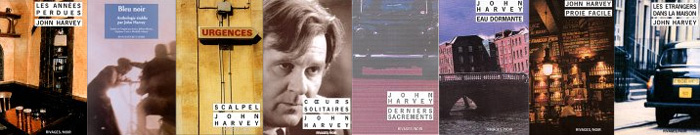
Après avoir écrit de nombreux westerns, vous êtes passé à la fiction criminelle. Comment s’est opéré ce passage ?
Ma foi, vous savez, cela ne s’est pas fait de façon aussi tranchée. En fait, avant d’écrire la plupart de mes westerns, j’ai écrit pour une collection de poche quatre romans policiers dont le personnage principal, Scott Mitchell, était un détective privé anglais. Ils ont été publiés par Sphere entre les années 75 et 79. Lorsque, plus tard, la transition s’est opérée, elle a elle-même été interrompue par toutes sortes de travaux de commande pour la télévision, dont le point culminant fut l’écriture de deux saisons de la série Hard cases, qui avait pour sujet le service du contrôle judiciaire de Nottingham et ses clients, et constituait une tentative d’élaboration d’une série fortement inspirée de Hill Street Blues. Les romans consacrés à Resnick découlent plutôt de cette expérience-là que de l’écriture des westerns ou de quoi que ce soit d’autre.
Vous êtes né à Londres et pourtant vos romans criminels sont situés à Nottingham. Pourquoi, et qu’est-ce qui vous intéresse dans cette ville de province ?
J’ai vécu à Nottingham pendant trois ou quatre ans à la fin des années 60, lorsque j’enseignais, puis encore pendant quatorze ans du milieu des années 70 jusqu’il y a cinq ans. J’y ai passé plus de temps de ma vie d’adulte que dans n’importe quelle autre ville ; c’est donc celle que je connais le mieux. C’est une ville postindustrielle de dimensions plutôt modestes ; elle constituait donc le cadre idéal pour parler des années Thatcher et post-Thatcher en Grande-Bretagne - ce qui est l’une des choses que je fais dans les romans consacrés à Resnick.
Le personnage de Charlie Resnick vous a-t-il été inspiré par un personnage réel ?
Non.
Vous paraissez révolté par la violence. Vous paraît-elle plus présente aujourd’hui que pendant votre enfance ?
Oui, effectivement, elle me paraît plus présente aujourd’hui : le langage, les attitudes des automobilistes, par exemple ; les termes utilisés dans les graffitis ; la violence physique est plus fréquente (me semble t-il) ; et en général les gens font preuve d’une bien plus grande tolérance envers elle. Il me semble que nous sommes trop prompts à y avoir recours et que nous sommes devenus comme désensibilisés à la violence - en partie parce que beaucoup de films et de plus en plus de romans nous encouragent à en rire. Mais, d’autre part, je ne rajeunis pas, et c’est pourquoi je suis de moins en moins tolérant envers elle.
Votre écriture est autant influencée par la tradition du « Whodunit » que par le roman noir américain. Comment vous-situez-vous exactement ?
Je ne pense pas du tout écrire des « Whodunits » (sinon par accident). Je ne me sens absolument aucun lien avec cette école, mais d’autre part je ne crois pas m’inscrire dans la tradition du roman noir américain non plus, encore que cela dépende des limites que l’on fixe au genre. Ce que je veux dire, c’est que je vois très peu de ressemblances entre mon œuvre et, par exemple, celle de James Ellroy - ou, en remontant plus loin dans le passé, celle de James Cain. En revanche, je me sens très proche d’Elmore Leonard et, dans une moindre mesure, de Ross Thomas et George V.Higgins. Je crois être, aussi, fortement influencé par la tradition « réaliste » britannique, dont les racines se trouvent, pour la plupart, dans la Grande-Bretagne provinciale -D.H. Lawrence et Alan Sillitoe à Nottingham, bien sûr, et par des réalisateurs tels que Ken Loach. Donc, ce que je fais provient d’un étrange mélange d’Elmore Leonard et de Hill Street Blues d’une part, et de Amants et fils, Samedi soir, dimanche matin, et Kes et Poor Cow de l’autre.
Dans vos interviews, vous citez Elmore Leonard et Ross Thomas. En quoi vous intéressent-ils ?
Ce que j’aime chez eux, c’est leur utilisation du dialogue pour présenter les personnages et faire progresser l’histoire. Des personnages qui sont extraordinairement « vrais » et qui ont une forte personnalité. Un mélange d’humour presque surréaliste et de crime violent. La brièveté des descriptions, la rapidité du récit, et en même temps le fait qu’ils n’hésitent pas à emprunter des détours qui procurent du plaisir au lecteur (et à l’auteur aussi.) La capacité qu’ils ont, par leur écriture, de procurer au lecteur un plaisir sans mélange.
Quelle a été l’influence de la série Hill Street Blues sur votre travail ? Vous sentez-vous proche d’Ed McBain ?
Influence énorme dans le cas d’Hill Street Blues, en ce qui concerne la façon de faire varier les centres d’intérêts et les lignes narratives. McBain, je suppose, a eu une influence formative ; j’ai lu, bien sûr, tous ses premiers livres (avant de commencer à écrire) et je les ai aimés. Je connaissais donc leur existence quand j’ai commencé les Resnick, mais je les ai pas véritablement lus à ce moment-là. Je vois bien les rapprochements que l’on peut faire entre mon travail et le sien, bien qu’a mon sens nos styles soient différents, et que (en général) j’ai dans mes livres des préoccupations d’ordre social qui sont plus perceptibles que les siennes.
Le jazz est présent dans vos romans, mais sous forme de référence. Vous n’avez jamais été tenté d’écrire un roman sur le jazz ?
Je ne pense pas connaître suffisamment le processus de la création, de l’exécution musicale pour le faire. J’envisage d’écrire un roman situé dans la Grande-Bretagne des années 50, qui se prolongerait dans les années 60, et dont l’un des quatre protagonistes principaux serait un musicien de jazz. Cela m’en rapprochera peut-être.
Dans un de ses films, Woody Allen assure que la novellisation est une stupidité. Vous qui en avez publié sept, qu’en pensez-vous ?
C’est une façon de gagner de l’argent rapidement et sans trop d’efforts, et en tant que telles, elles sont parfois nécessaires.
Vous avez écrit plusieurs romans pour adolescents chez Scholastic. Modifiez-vous votre écriture pour vous adresser à ce public ?
Oui, bien sûr. Je choisis mon sujet en conséquence et j’essaie de ne pas laisser mon style devenir trop « difficile ». Mais cela remonte à de nombreuses années à présent, bien que François Guérif ne cesse de m’inciter à écrire pour lui un roman destiné à de jeunes adultes. J’ai effectivement une idée de livre et j’ai en tête plusieurs rebondissements et quelques scènes, si bien que je le ferai peut-être*.
Vous avez adapté des romans et des nouvelles pour la radio. Il s’agit d’un travail alimentaire ou d’un réel intérêt pour la radio ?
Non, j’adore la radio (à peu près autant que je déteste 95% de ce que l’on voit à la télévision). Je suis suffisamment âgé pour avoir grandi dans une famille qui faisait cercle autour de la radio afin d’écouter des pièces de théâtres, etc...
On ne connaît pas votre poésie en France. Quelles sont vos références dans ce domaine ?
Peut-être (si j’en ai), les poètes New-Yorkais des années 50 et 60, Frank O’Hara et James Schuyler, mais le tout encore une fois corsé par une bonne dose de « réalisme » britannique. Il y a un poète anglais nommé Lee Harwood, dont l’œuvre est au moins un petit peu connue en France, sur qui j’ai modelé beaucoup de mes premiers poèmes et dont je me sens poétiquement très proche. Il y a tout un groupe, très divers, de poètes provinciaux britanniques qui sont populaires actuellement - Carol Ann Duffy, Simon Armitage, etc... - avec qui je me sens également des affinités très fortes.
Slow Dancer Press, que vous avez créé en 1977, a publié de nombreux poètes. Depuis peu vous éditez également de la fiction. Pourquoi cette évolution ?
Depuis quelques années, je me rendais compte qu’il y avait des auteurs de romans criminels, souvent passionnés de musique, dont les livres n’étaient plus disponibles ou n’avaient jamais été publiés au Royaume-Uni. Cela semblait bien cadrer avec le genre de poésie que nous publions. De plus, je désirais depuis un certain temps que nos éditions deviennent un peu plus professionnelles et voir si je pouvais « me lancer dans l’aventure ». Puis, quand avec Sarah Boiling nous avons commencé à vivre ensemble il y a quatre ans ou cinq ans, elle possédait des compétences - concernant la commercialisation et la fabrication - que je n’avais pas dans ce domaine de l’édition et qui complétaient les miennes. J’ai donc décidé d’essayer de publier des romans et d’éditer davantage de poésie en même temps ; de publier des auteurs que j’admirais dans des livres bien conçus et de voir s’ils se vendraient suffisamment bien pour permettre à Slow Dancer Press de continuer à exister. Malheureusement, sauf pour un ou deux titres, ce ne fut pas le cas.
Vous avez enseigné dans un atelier d’écriture en Californie. Pensez-vous vraiment qu’on puisse former des écrivains dans une école ?
Je pense que si quelqu’un écrit déjà et désire réussir, vous pouvez l’aider dans cette voie, tant qu’il est disposé à vous écouter.
Dans un numéro de la revue française Polar, Maxim Jakubowski faisait état d’une scène anglaise du roman noir particulièrement riche et active. Qu’en pensez-vous ? Comment vous situez-vous parmi ce mouvement ?
Je ne pense pas faire partie de la scène du roman noir anglais bien que d’une certaine façon je sois reconnaissant à Maxim de m’y inclure ! Je considère comme auteurs de romans noirs des écrivains tels Ken Bruen, Carol Ann Davis, Denise Danks, Mark Timlin et, bien sûr, le regretté Robin Cook. J’aime certaines de leurs œuvres, sans avoir le sentiment d’appartenir à cette école. En fait, la plupart de leurs romans sont trop violents pour que je prenne du plaisir à les lire. Si je me sens des affinités avec des auteurs britanniques de romans criminels, c’est avec des gens comme Bill James, Brian Thompson et Ian Rankin et (dans une moindre mesure) William Mcllvanney. Nous sommes des réalistes sociaux qui écrivons des polices procédurales et des satiristes sociaux, dans le cas de Bill et Brian.
À présent que vous avez terminé la série des romans consacrés à Charlie Resnick, avez-vous en tête un nouveau personnage ?
Pas comme personnage central d’une autre série, non. J’aimerais écrire plusieurs romans indépendants les uns des autres, avant, peut-être, de reprendre le personnage de Resnick. Mais il ne sera plus policier à Nottingham. Que fait-il, maintenant ?
La série des Resnick décrit la hiérarchie et le fonctionnement de la police britannique de façon impressionnante. Comment êtes-vous parvenu à la connaître aussi bien ?
C’est la magie ! L’imagination. C’est ce que font les écrivains. C’est ce qui fait d’eux des écrivains créatifs. J’ai bien effectué quelques recherches de bases, mais très limitées.
Saviez-vous dès le départ que la série Resnick se limiterait à dix romans ? Avez-vous dès le début conçu les personnages de toute son équipe ? Par exemple, aviez-vous prévu que Diptak Patel se ferait tuer dans le quatrième roman et que Sharon Garnett apparaîtrait dans le volume 6 ?
Après que Viking m’eut fait comprendre que Cœurs solitaires leur plaisait assez pour qu’ils me commandent deux autres livres, j’ai compris que ce que j’écrivais constituait une série. Je n’ai jamais fait de plans longtemps à l’avance, j’ai toujours terminé un livre sans savoir ce que serait le prochain (bien que, dans le dernier, j’aie essayé de régler quelques problèmes en suspens.) Patel est mort parce que cela devenait inévitable au cours du développement de l’intrigue. Sharon est apparue parce que je commençais à me lasser de certains autres officiers subalternes.
* Ce livre a paru dans la collection Rat Noir. D’autre part, tous les livres de John Harvey sont disponibles chez Rivages.